Au premier abord, la révolution qui explose aux premiers jours de novembre dans le Reich semble confirmer l'attente et les vues de Rosa Luxemburg. Les masses ouvrières se fraient leur chemin vers l'action révolutionnaire malgré leurs dirigeants et souvent contre eux, de façon presque indépendante des organisations révolutionnaires, dépassées par l'événement, en l'absence de tout mot d'ordre unificateur et finalement de toute direction. En même temps, c'est vers une forme nouvelle d'organisation du pouvoir d'État, l'État « ouvrier » des conseils d'ouvriers et de soldats, de type soviétique, qu'elle semble se diriger, conformément aux appels lancés depuis des mois par la propagande clandestine des spartakistes : le mot d'ordre des « conseils » devient une force matérielle, repris par des millions d'hommes.
Les dirigeants et la défaite militaire.
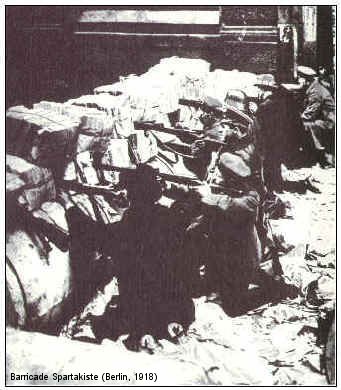 Les dirigeants allemands ont senti venir l'orage. L'échec de Montdidier, sur le front ouest, le 8 août, a été le signe que tout espoir de victoire militaire était vain et que les chefs n'avaient plus désormais de prise sur la conduite de la guerre, devenue « jeu de hasard » [1]. A la mi-août, l'empereur a conféré avec son chancelier, Hertling, les chefs de l'armée, Hindenburg et Ludendorff, avec l'empereur d'Autriche : ils sont tous d'accord sur la nécessité de guetter le moment le plus favorable pour demander la paix, et le secrétaire d'État Hintze a fait connaître au président Wilson le désir du gouvernement allemand de traiter sur la base du retour au statu quo ante [2].
Les dirigeants allemands ont senti venir l'orage. L'échec de Montdidier, sur le front ouest, le 8 août, a été le signe que tout espoir de victoire militaire était vain et que les chefs n'avaient plus désormais de prise sur la conduite de la guerre, devenue « jeu de hasard » [1]. A la mi-août, l'empereur a conféré avec son chancelier, Hertling, les chefs de l'armée, Hindenburg et Ludendorff, avec l'empereur d'Autriche : ils sont tous d'accord sur la nécessité de guetter le moment le plus favorable pour demander la paix, et le secrétaire d'État Hintze a fait connaître au président Wilson le désir du gouvernement allemand de traiter sur la base du retour au statu quo ante [2].La situation s'aggrave en septembre sur les fronts tenus par les alliés austro-hongrois et bulgares. Les chefs militaires se font plus pressants : le 29 septembre, Hindenburg et Ludendorff informent le chancelier que la situation sur le front de l'est est devenue critique, et formulent leur désir de voir le gouvernement élargi pour permettre la négociation sur la base la plus solide possible [3]. Ils pensent en effet, avec le secrétaire d'État Hintze, qu'« il faut prévenir le bouleversement d'en bas par la révolution d'en haut » [4]. L'objectif est de constituer un gouvernement conforme à la majorité existant au Reichstag et comprenant en particulier des ministres social-démocrates.
Le chancelier Hertling démissionne et Guillaume Il fait appel, pour le remplacer, au prince Max de Bade, grand seigneur progressiste teinté d'une réputation de libéral. Le prince choisit ses ministres parmi les députés des partis décidés à soutenir une politique de négociations immédiates : le parti social-démocrate délègue Bauer et Scheidemann [5]. Le 4 octobre, le gouvernement Max de Bade propose au président Wilson la conclusion d'un armistice sur la base des « quatorze points ». Le 8 novembre il envoie aux Alliés la délégation chargée de conclure l'armistice : déjà les chefs militaires - Ludendorff, en particulier - parlent de conditions « inacceptables » et tentent de rejeter la responsabilité de la paix qui se prépare sur les épaules des « politiciens ». Pourtant, ils ne tentent aucun effort pour l'empêcher : la menace révolutionnaire est à leurs yeux très concrète et tout dépend en fait dans une large mesure du parti social-démocrate qui s'emploie pour le moment de toutes ses forces en faveur d'une transition pacifique. Le Vorwärts mène campagne pour démontrer que les « solutions russes » sont impraticables en Allemagne :
« La révolution russe a écarté la démocratie et établi à sa place la dictature des conseils d'ouvriers et de soldats. Le parti social-démocrate rejette sans équivoque la théorie et la méthode bolcheviques pour l'Allemagne et se prononce pour la démocratie. » [6]
Le 4 novembre encore, Ebert téléphone au secrétaire d'État Wahnschaffe pour l'assurer que les syndicats emploient toute leur autorité à apaiser les ouvriers [7].
Les premiers craquements.
En septembre déjà, les signes se multipliaient d'une radicalisation croissante. A la conférence du parti indépendant, Haase, Dittmann, Hilferding ont quelque peine à faire rejeter le mot d'ordre de « dictature du prolétariat », et doivent s'employer à dénoncer le « goût romantique pour la révolution bolchevique » [8]. Kautsky développe les mêmes thèmes que le Vorwärts [9]. Haase avoue à Däumig qu'il n'a aucune idée de ce qui va se passer [10]. Lénine, lui, écrit à Spartakus : « Le moment est venu » [11] et prescrit l'étude de tous les moyens possibles pour venir en aide à la révolution allemande.
Le 7 octobre se tient à Berlin une conférence de Spartakus à laquelle prennent part les délégués des communistes de Brême. Elle analyse la situation de l'Allemagne comme « une situation révolutionnaire dans laquelle se posent de manière nouvelle tous les problèmes que la bourgeoisie allemande a été incapable de résoudre dans la révolution de 1848 ». Elle affirme la solidarité de la révolution qui vient avec la révolution russe et élabore un programme immédiat comportant l'amnistie pour tous les adversaires de la guerre, civils et militaires, l'abolition de la loi sur la main-d'œuvre et la levée de l'état de siège. Son programme d'action comporte l'annulation de tous les emprunts de guerre, la saisie des banques, mines et usines, la réduction du temps de travail, l'augmentation des bas salaires, la saisie des propriétés rurales grandes et moyennes, l'octroi aux militaires du droit d'organisation et de réunion, l'abolition du code militaire et la remise des fonctions disciplinaires à des délégués élus par les soldats, l'abolition des tribunaux militaires et la libération immédiate de ceux qu'ils ont condamnés, l'abolition de la peine de mort et des travaux forcés pour « crimes » politiques ou militaires, la remise des moyens de ravitaillement aux délégués des travailleurs, l'abolition des Länder et la destitution des dynasties royales et princières. Pour la réalisation de ce programme, elle lance un appel à « la constitution de conseils d'ouvriers et de soldats partout où ils n'existent pas encore » [12]. A l'approche de la révolution, les révolutionnaires se portent candidats à sa direction.
Les ministres social-démocrates ont conscience du danger et c'est autour de ce thème que tournent leurs interventions en conseil de cabinet [13]. Ils insistent pour que soit rapidement décrétée l'amnistie pour les détenus politiques [14]. Ils pensent en particulier qu'il faut libérer Liebknecht, à qui la détention procure une auréole de martyr : mesure dangereuse certes, mais nécessaire, si l'on veut convaincre l'opinion ouvrière en lui fournissant une preuve de la volonté de démocratisation des nouveaux dirigeants. Scheidemann finit par convaincre ses collègues, malgré la résistance des chefs de l'armée, et la libération du dirigeant spartakiste est décidée le 21 octobre [15]. Dans les jours qui suivent, des centaines de militants, dont certains détenus depuis des années, sont remis en liberté.
A une réunion des responsables syndicaux de Berlin qui se tient dans la soirée du 22 octobre, sous la présidence d'Alwin Körsten, le métallo Paul Eckert, ayant obtenu la parole sur l'ordre du jour, lance la nouvelle qui fait l'effet d'une bombe : Karl Liebknecht est libéré, il arrivera le 23 octobre à 17 heures à Berlin [16]. La majorité des délégués manifeste sa joie en chantant l'Internationale, et la police intervient [17]. Le lendemain, plusieurs milliers de personnes, étroitement canalisées par d'importantes forces de police, attendent le prisonnier libéré et lui font un accueil triomphal. En militant avide d'action, celui-ci se lance dès la sortie de la gare de Potsdam dans la bataille : sur la place où il avait été arrêté deux ans auparavant, il harangue la foule, célèbre l'exemple révolutionnaire russe, appelle à la révolution prolétarienne allemande [18]. Le soir même, l'ambassadeur soviétique Joffé donne en son honneur une spectaculaire réception, lit un télégramme de congratulations de Lénine, auquel Liebknecht répond. D'autres militants allemands, Walcher, Haase, Barth, Globig, Otto Rühle, prennent la parole [19]. Nombre des présents, ce qui reste à cette date des différents états-majors révolutionnaires, pensent que Liebknecht est capable d'unifier le mouvement révolutionnaire dont il est à la fois le héros et le symbole.
Pourtant, paradoxalement, Liebknecht est seul. Il pense qu'il n'y a plus de temps à perdre et que la révolution n'a que trop tardé, mais il sait aussi qu'il peut lui apporter un drapeau, non un état-major. Ses amis spartakistes ne peuvent jouer ce rôle. Certes, Otto Franke est bien implanté dans le noyau des délégués révolutionnaires [20], Levi, au travail depuis plusieurs mois, sert de lien avec les radicaux de Brême [21] et Wilhelm Pieck est revenu de Hollande pour reprendre son travail militant [22]. Mais ce ne sont encore que des chefs sans troupes, au moins à Berlin, dont le rôle sera décisif, et où ils ne sont pas plus d'une cinquantaine [23].
La vraie avant-garde des troupes dans les usines est organisée dans les rangs du parti social-démocrate indépendant sous la direction des centristes avec lesquels Liebknecht a rompu tant de lances, et particulièrement dans le noyau des délégués révolutionnaires des usines. Et le problème d'un lien direct se pose.
Les dirigeants indépendants prennent l'initiative ; conscients du risque qu'ils courent d'être débordés, ils voudraient à la fois contrôler Liebknecht et utiliser son prestige à leur profit : ils lui offrent d'être coopté à la direction du parti [24]. La proposition est à bien des égards tentante : le parti indépendant compte de nombreux militants, dispose d'importants moyens d'expression. Mais Liebknecht n'est pas prêt à un compromis sans principes : il demande qu'on lui donne des garanties, qu'on convoque un congrès dont il croit qu'il condamnerait les atermoiements passés de la direction centriste, et qu'on reconnaisse que les spartakistes ont eu raison au cours des dernières années : il ne veut pas courir le risque d'être, à la direction, un otage. Mais les dirigeants indépendants ne sont pas décidés à une telle concession qui est presque un suicide politique ; ils acceptent seulement la rédaction d'une déclaration d'intentions reconnaissant que leur point de vue s'est rapproché de celui de Spartakus. Ce n'est pas suffisant aux yeux de Liebknecht, qui décline la cooptation offerte, mais accepte d'être invité à l'exécutif indépendant chaque fois qu'il s'agira de prendre une décision importante [25].
Il ne lui reste plus qu'à se tourner vers les délégués révolutionnaires, qui lui fourniront un cadre, un réseau étendu à travers toutes les usines de la capitale, bref, un instrument d'action révolutionnaire. De ce côté, il ne se heurte à aucune difficulté : le 26, le noyau qui décide de s'ériger en conseil ouvrier provisoire coopte trois spartakistes : Liebknecht lui-même, Pieck et Ernst Meyer [26]. Cette direction révolutionnaire improvisée passe aussitôt à la discussion de la situation et des perspectives, pour conclure à la nécessité d'être prêts à une action immédiate au cas où le gouvernement Max de Bade refuserait la poursuite des pourparlers de paix et lancerait un appel à la défense nationale [27]. Mais Liebknecht n'est pas satisfait de cette analyse, qu'il juge purement passive, soumise en fait à l'initiative de l'adversaire. Il refuse de suivre les délégués qui affirment que les masses ne sont pas prêtes à se battre, à moins d'une provocation gouvernementale. Il voit la preuve du contraire dans les initiatives qui se sont produites un peu partout dans le pays, et dans la combativité des jeunes qui ont tenu précisément leur congrès à Berlin les 26 et 27. Le 26 au soir, il y a eu 2 000 manifestants à Hambourg, le 27 le double à Friedrichshafen. Le 27 au soir, à la sortie d'un meeting indépendant au cours duquel il a pris la parole à l'Andreas Festsäle, il entraîne derrière lui vers le centre de la ville plusieurs centaines de jeunes et d'ouvriers qui se heurtent à la police [28]. C'est par des actions de ce genre, en s'appuyant sur les détachements les plus combatifs, qu'on réalisera la mobilisation des masses.
Il tente d'en convaincre les dirigeants des délégués révolutionnaires : au cours de la journée du 28 octobre, il a une longue discussion avec Däumig et Barth. Selon lui, dans tous les cas, et même si le gouvernement ne tente pas de prolonger la guerre au nom de la « défense nationale », les révolutionnaires ont le devoir de préparer la mobilisation des masses par des meetings et des manifestations qui leur feront prendre conscience de leur force, élèveront leur niveau de conscience et leur volonté de vaincre. Däumig et Barth hésitent, sont près d'accuser Liebknecht de prendre ses désirs pour des réalités, ne consentent finalement qu'à l'organisation de meetings, repoussant catégoriquement celle de manifestations de rue [29]. A la réunion plénière du soir, Wilhelm Pieck fait adopter sa proposition de diffuser un tract invitant les ouvriers à refuser les appels sous les drapeaux qui sont en train de leur parvenir [30]. Liebknecht réitère sa proposition d'organiser systématiquement meetings et manifestations de rue et propose de les concentrer, pour commencer, sur la journée du 3 novembre. Däumig, Barth, Richard Müller combattent la proposition : l'adopter serait, estiment-ils, courir le risque d'engager prématurément la bataille décisive. Les révolutionnaires, affirment-ils, ne doivent frapper qu'à coup sûr, et l'un d'eux [31] ironise sur le plan de Liebknecht, qu'il qualifie de « gymnastique révolutionnaire ».
En fait, ses adversaires au sein du conseil provisoire ne font que reprendre les arguments que développent au même moment les dirigeants du parti social-démocrate indépendant également hostiles à l'action ouverte. En vain Liebknecht s'emploie-t-il à tenter de les convaincre : le mouvement des masses, dit-il, ne peut se déployer que dans la rue, et le devoir des dirigeants est de les y conduire dès que possible. Il ajoute que ceux qui se retranchent derrière un rapport de forces encore défavorable reculent en réalité devant un combat nécessaire, car la situation ne deviendra favorable aux révolutionnaires qu'à partir du moment où ils se lanceront dans la bataille : en particulier, les soldats respecteront la discipline et exécuteront les ordres de leurs officiers tant qu'ils n'auront pas en face d'eux une perspective révolutionnaire sérieuse ; c'est seulement dans la rue, par la fraternisation avec les prolétaires sous l'uniforme, que les ouvriers peuvent venir à bout de forces armées matériellement supérieures, mais politiquement en état d'infériorité face à l'action unie de la classe ouvrière [32].
Le 2 novembre se tient une réunion commune des dirigeants indépendants et des délégués révolutionnaires. Ledebour y introduit un officier du 2° bataillon de la Garde, le lieutenant Waltz, venu lui dire qu'il se mettait avec son unité à la disposition de l'état-major révolutionnaire pour une insurrection [33]. La majorité des présents accueillent avec enthousiasme ce nouveau venu qui leur apporte force armée et matériel et rend enfin concevable une victoire de l'insurrection. Waltz, sous le pseudonyme de « Lindner », est adjoint à Däumig dans les préparatifs techniques militaires et stratégiques de l'insurrection à venir [34]. Pourtant les rapports des délégués des usines demeurent pessimistes. Sur 120 000 ouvriers que contrôle le réseau, 75 000 au plus sont selon eux prêts à répondre par la grève et des manifestations au premier appel des dirigeants [35]. Peut-on envisager une action insurrectionnelle sans passer par l'étape de la grève générale ? Sur cette question également, les responsables sont divisés.
Haase, énergiquement soutenu par Richard Müller, propose de fixer au 11 novembre la date de l'insurrection armée et de s'y préparer immédiatement. Ledebour rétorque que cette proposition ne fait que dissimuler une dérobade et un refus d'agir : pour lui, il faut fixer l'insurrection au surlendemain, 4 novembre. Liebknecht, qui, selon le témoignage de Pieck, vient de discuter de ce problème avec les Russes de l'ambassade, les combat les uns et les autres. Il rejette en effet catégoriquement toute proposition tendant à déclencher l'insurrection armée sans préparation et mobilisation des masses. Il faut, selon lui, lancer le mot d'ordre de grève générale, faire décider, par les grévistes eux-mêmes l'organisation de manifestations armées pour la paix immédiate, la levée de l'état de siège, la proclamation de la république socialiste et du gouvernement des conseils d'ouvriers et de soldats. C'est seulement, affirme-t-il, au cours de la grève générale, que « l'action devrait être élevée par des mesures de plus en plus hardies jusqu'à l'insurrection » [36]. Au vote, la motion Ledebour est rejetée par 22 voix contre 19, et la motion Liebknecht par 46 voix contre 5. Il ne reste plus que la motion Haase, qui équivaut en fait à une décision attentiste [37].
La conclusion de cette dernière discussion constitue pour Liebknecht un échec grave. L'intervention du dirigeant spartakiste dans l'état-major des délégués révolutionnaires n'a pu venir à bout des hésitations de la majorité des délégués des usines, ni surtout des réticences ou de l'hostilité des dirigeants indépendants Non seulement aucun progrès n'a été réalisé dans la voie de l'organisation et de l'action des révolutionnaires, mais encore Liebknecht semble lui-même moralement prisonnier des contradictions qui étreignent, à travers les délégués, le parti social-démocrate indépendant.
La situation n'est cependant pas identique partout. A Stuttgart, les spartakistes occupent de fortes positions dans le parti indépendant, puisque c'est l'un des leurs, Fritz Rück, qui préside l'exécutif du parti dans le Wurtemberg, et qu'ils disposent du journal régional Der Sozialdemokrat. Dès septembre, ils sont à même de contrôler, par l'intermédiaire d'un comité d'action clandestin de cinq membres - dont Thalheimer et Rück lui-même - un réseau de délégués d'usines [38]. Rück écrit dans son « journal » :
« Il s'agit de mettre les masses en mouvement. Cela ne peut se faire qu'à partir des usines. L'adhésion officielle au parti indépendant, pour antipathique qu'elle nous soit politiquement, nous laisse les mains libres et nous permet de construire dans les usines, sous la couverture d'un travail d'organisation du parti légal, un système bien soudé d'hommes de confiance. » [39]
Il participe à la conférence spartakiste du 7 octobre. Après son retour, le 16, il réunit clandestinement 40 délégués d'usine pour déterminer avec eux les tâches de l'insurrection [40]. Le lendemain, le Sozialdemokrat est suspendu pour quinze jours, Rück ayant pris la responsabilité de passer outre aux décisions des censeurs. Mais le groupe a une presse clandestine. Le 30, l'assemblée locale du parti indépendant décide de lancer un manifeste pour la convocation centrale d'un pré-parlement de conseils d'ouvriers et de soldats, et d'organiser une manifestation dans la rue. Dans la nuit du 30 au 31, les équipes de nuit de l'usine Daimler se réunissent en assemblée générale pour écouter Rück qui les appelle à élire clandestinement leur conseil ouvrier. Le 2 novembre, deux délégués du comité d'action de Stuttgart, qui ont pris part à Berlin aux discussions des délégués révolutionnaires, reviennent avec l'information suivant laquelle l'insurrection va être fixée au 4 [41]. Dans la nuit du 2 au 3, on tire les tracts. Le conseil ouvrier élu à l'usine Daimler s'ouvre à des délégués des autres entreprises, décide la grève générale pour le 4. Le 4, la grève est effective. Le conseil ouvrier local, constitué par élargissement du conseil ouvrier de Daimler, forme son bureau, élit Rück à la présidence et décide l'organisation d'élections de conseils ouvriers dans toutes les usines sur la base d'un délégué pour 500 ouvriers. Il décide la publication immédiate d'un journal, Die Rote Fahne (Le Drapeau rouge), qui se prononce immédiatement pour l'établissement en Allemagne d'une république des conseils [42].
Mais le mouvement ainsi né à Stuttgart reste isolé, puisque les révolutionnaires berlinois ont décidé d'attendre. Le conseil ouvrier de Stuttgart, maître de la ville où se sont déroulées de gigantesques manifestations, est dangereusement en flèche, car le gouvernement et les autorités légales du Land demeurent en place. Comme, à Friedrichshafen, les ouvriers de l'usine Zeppelin, touchés par la propagande venue de Daimler, viennent de constituer leur conseil ouvrier, Thalheimer et Rück s'y rendent afin de coordonner l'action. Ils sont arrêtés pendant le trajet [43]. Privés de leurs têtes, les membres du conseil de Stuttgart, un instant désorientés, sont arrêtés à leur tour. Le premier combat d'avant-garde tourne court. La police, partout, semble réagir. Elle arrête, dans toutes les grandes villes, des militants poursuivis en raison de leur action... pendant les grèves de janvier. Le 5 novembre, la police prussienne ayant provoqué la découverte d'un abondant matériel de propagande dans la valise diplomatique, le gouvernement du Reich donne six heures à Joffé et aux représentants russes de l'ambassade de Berlin pour quitter le territoire allemand [44]. Mesure symbolique, pour couper les liens évidents entre la révolution russe d'hier et la révolution allemande de demain ? Mesure trop tardive en tout cas, car, à cette date, le calendrier de la révolution a déjà été déterminé par l'action des marins de Kiel.
Une vague venue de Kiel.
L'agitation a commencé dans les équipages de la marine cantonnés à Wilhelmshaven le 28 octobre. Un ordre d'appareiller donne naissance à des rumeurs inquiètes : l'état-major se préparerait à un baroud d'honneur en mer du Nord. Plusieurs manifestations se produisent à bord : un millier d'hommes sont arrêtés et débarqués, et cinq navires sont dirigés sur Kiel [45].
L'inquiétude sur le sort de détenus déclenche le mouvement : les marins se souviennent du sort des mutins de 1917 et cherchent l'appui des ouvriers. Le 1° novembre, ils se réunissent à la maison des syndicats de Kiel et décident la tenue d'un meeting le 2 novembre [46]. Le 2, la maison des syndicats est gardée par la police, et les marins se rassemblent sur la place d'exercice. L'un d'eux, Karl Artelt, membre du parti indépendant, condamné en 1917 à cinq mois de prison, propose l'organisation d'une manifestation de rues pour le lendemain : les marins y appellent par tracts manuscrits [47]. Le 3, il y a plusieurs milliers de marins et soldats, peu cependant par rapport aux effectifs de la garnison. La manifestation a été interdite et les patrouilles militaires sillonnent la ville. Malgré un appel au calme d'un responsable syndical, les marins décident de manifester dans les rues : ils se heurtent à une patrouille qui tire : neuf morts, vingt-neuf blessés. Le choc s'est produit qui va mettre en mouvement les hommes de la garnison de Kiel, puisque, désormais, les marins ne peuvent plus reculer [48].
Ils se réunissent pendant la nuit sur les navires. C'est encore Artelt qui prend l'initiative de faire élire sur un torpilleur le premier conseil de marins de la révolution allemande. Au petit matin, il se retrouve à la tête d'un comité désigné par 20 000 hommes. Les officiers sont débordés. L'amiral Souchon qui commande la base fait droit à toutes les revendications que lui présente Artelt au nom de ses camarades : suppression du salut, allègement du service, augmentation des permissions, libération des détenus. Le soir, toute la garnison est organisée en un réseau' de « conseils de soldats », le drapeau rouge flotte sur les navires de guerre, nombre d'officiers ont été arrêtés par leurs hommes. A terre, social-démocrates indépendants et majoritaires ont appelé ensemble à la grève générale puis à la désignation d'un conseil ouvrier qui va fusionner avec le conseil des marins. Le social-démocrate Gustav Noske, nommé gouverneur de Kiel par le gouvernement, s'empresse de reconnaître l'autorité du nouveau conseil d'ouvriers et de soldats afin de rassurer les marins et de circonscrire l'incendie [49]. Le 6 novembre, le calme semble être revenu.
Pourtant, la mutinerie de Kiel a mis le feu aux poudres. La peur des représailles pousse partout les marins à élargir le mouvement. A Cuxhaven, un militant indépendant, Karl Baier, ouvrier mobilisé dans la marine, alerte le petit réseau d'hommes de confiance qu'il a constitué autour de lui dès qu'il apprend ce qui se passe à Kiel. Les marins se réunissent à la maison des syndicats dans la soirée du 6 novembre, élisent un conseil de soldats au moment où dans les usines les ouvriers font de même, préparant la désignation d'un conseil ouvrier que préside Kraatz, un des organisateurs de la grève de janvier à Berlin. Le nouveau conseil des ouvriers et des soldats demande du renfort à Hambourg, qui leur envoie Wilhelm Düwell [50]. A Wilhelmshaven, le lendemain 7 novembre, une manifestation de marins organisée par le chauffeur Bernhard Kuhnt, permanent du parti avant guerre à Chemnitz, déclenche la grève générale : le soir même, ouvriers et marins élisent un conseil où les social-démocrates sont en majorité et que préside Kuhnt [51]. A Brême, la presque totalité des militants révolutionnaires sont en prison ou à l'armée, et l'impulsion va venir de l'extérieur. Le 4, un meeting de masse, harangué par le député indépendant Henke, réclame l'armistice, l'abdication de l'empereur, la levée de l'état de siège [52]. Mais les lendemains sont calmes. Le 6, cependant, un incident mécanique bloque en gare un train transportant des marins détenus : ils se répandent en ville et sur les chantiers, appellent les travailleurs à leur rescousse [53]. Une manifestation s'organise spontanément, dont les dirigeants indépendants prennent la tête : après l'ouverture des portes des prisons, l'indépendant Frasunkiewicz lance un appel à l'élection de conseils d'ouvriers et de soldats et fait acclamer le mot d'ordre de « république socialiste », mais le meeting se disperse sans avoir pris de décision [54]. C'est seulement le 7 novembre que la grève, partie des chantiers de la Weser, se généralise et que les conseils ouvriers sont élus dans toutes les usines. Le conseil central local des ouvriers et des soldats est désigné le 9 [55].
A Hambourg, le 5 au soir, a lieu un meeting, depuis longtemps prévu, du parti indépendant. Dittmann tient tête à des marins qui réclament l'organisation d'une manifestation pour la libération des détenus de Kiel, et fait repousser une motion de Wilhelm Düwell en faveur de l'élection de conseils ouvriers [56]. Pendant la nuit, un quartier-maître qui refuse de s'avouer battu, Friedrich Zeller, organise un détachement d'une vingtaine de marins et va sur les quais chercher des appuis. Au milieu de la nuit, ils sont une centaine qui s'installent à la maison des syndicats et lancent un appel à une manifestation centrale à midi [57]. Dans la matinée, sous l'impulsion de quelques militants - notamment le responsable des Jeunesses, Friedrich Peter, déserteur revenu clandestinement à Hambourg -, l'action s'organise et un conseil ouvrier provisoire se constitue à la maison des syndicats avec à sa tête deux présidents, Zeller et le dirigeant indépendant local Kallweit [58]. L'état-major improvisé de la révolution lance des détachements pour occuper toutes les casernes : Peter trouve la mort dans la fusillade devant l'une d'elles [59]. A l'heure prévue, plus de 40 000 manifestants sont rassemblés. Un dirigeant indépendant fait acclamer la prise du pouvoir politique par le conseil des ouvriers et des soldats. Le radical de gauche Fritz Wolffheim fait approuver le mot d'ordre de république des conseils et Wilhelm Düwell la révocation du général commandant la place et la reconversion des usines [60]. Dans la soirée est mis en place le conseil des ouvriers et des soldats que préside le radical de gauche Heinrich Laufenberg [61]. Pendant ce temps, Paul Frölich, à la tête d'un groupe de marins armés, a occupé les locaux et l'imprimerie du quotidien Hamburger Echo et y publie le premier numéro du journal du conseil des ouvriers et des soldats de Hambourg, intitulé également Die Rote Fahne [62]. Il proclame :
« C'est le début de la révolution allemande, de la révolution mondiale! Salut à la plus puissante action de la révolution mondiale! Vive le socialisme ! Vive la République allemande des travailleurs ! Vive le bolchevisme mondial ! » [63]
La révolution, comme une nappe d'huile.
Parti des villes de la côte, le mouvement s'étend irrésistiblement. A Düsseldorf, le 6, on se bat autour d'un train de prisonniers arrêtés dans une gare et c'est sur place que se constitue le conseil d'ouvriers et de soldats [64].
En Bavière, le mouvement n'est pas déclenché par les marins, mais par un groupe révolutionnaire agissant dans les rangs du parti indépendant. Eisner, ancien révisionniste devenu radical par pacifisme, a organisé à Munich un cercle de discussion auquel ont participé une centaine d'ouvriers et d'intellectuels. C'est parmi eux que se sont recrutés les premiers adhérents du parti indépendant en Bavière. Ils ne sont guère plus de 400 à l'été 1918, mais ce sont des cadres bien formés qui exercent une influence déterminante parmi les travailleurs de l'usine Krupp et ont été capables de mettre sur pied un solide réseau d'hommes de confiance dans les autres entreprises [65]. Ils ont en outre noué des liens étroits avec l'aile socialisante de la Ligue paysanne qu'anime l'aveugle Gandorfer [66]. Eisner a préparé la révolution en utilisant systématiquement l'aspiration des masses à la paix. Le 7 novembre, il conduit dans les rues de Munich une manifestation pour la paix au cours de laquelle il fait décider la grève générale et l'assaut des casernes. Le roi s'enfuit et Eisner devient président du conseil des ouvriers et des soldats de la république bavaroise [67].
A Halle, ce sont des militants ouvriers de la ville qui débarquent du train, le 6 novembre, à la tête de marins mutinés [68]. Ils soulèvent les soldats du 14 ° chasseurs et, avec eux, donnent l'assaut aux autres casernes. Le marin Karl Meseberg, ancien militant local, indépendant, préside le conseil de soldats, qui fusionne bientôt avec le conseil ouvrier, né de l'action d'un réseau de délégués animé par les indépendants : l'indépendant Otto Kilian est le président du conseil d'ouvriers et de soldats [69]. A Erfurt, une grève de solidarité avec les mutins de Kiel permet des assemblées d'usine, le 7 novembre, et, après un meeting central, l'élection, le même jour, d'un conseil local central [70].
A Hanau, une manifestation ouvrière se heurte dans la journée aux forces de police : le jour même est désigné un conseil d'ouvriers et de soldats que préside le spartakiste Schnellbacher [71]. A Brunswick, le 7 novembre, des marins venus de l'extérieur organisent une manifestation et obtiennent l'ouverture des portes des prisons, cependant que les ouvriers grévistes désignent un conseil ouvrier. Le 8 novembre, le prince a abdiqué et le spartakiste August Merges, président du conseil des ouvriers et des soldats, s'intitule président de la république socialiste de Brunswick [72].
A Leipzig, le petit noyau spartakiste - vingt-cinq militants environ - tente vainement d'entraîner une assemblée des indépendants, le 7 novembre, à prendre l'initiative de lancer la grève générale [73]. Mais des marins venus des ports organisent ce jour-là les premières manifestations de rue, appellent les soldats à se soulever. Le 8, les casernes sont prises d'assaut, un conseil d'ouvriers et de soldats proclamé [74]. A Chemnitz, tout se passe presque dans l'ordre : Fritz Heckert est de retour le 8 novembre ; par le syndicat du bâtiment qu'il dirige et le parti indépendant dont il est le dirigeant de fait, il parvient à organiser simultanément la grève et l'élection d'un conseil d'ouvriers et de soldats dans lequel figurent des social-démocrates majoritaires ; il en est président le 9 novembre [75].
Pendant ces jours décisifs, les dirigeants révolutionnaires berlinois hésitent toujours. Le 4, les délégués réunissent leur noyau dès l'annonce des événements de Kiel. Liebknecht et Pieck proposent de fixer le début de l'action au 8 ou au 9novembre. Mais la majorité se refuse à lancer un mot d'ordre de grève pour ces jours qui sont jours de paie. Elles se contente de décider l'envoi d'émissaires en province et de confier à Pieck la rédaction d'un tract sur les événements de Kiel. Nouvelle réunion le 6 : Liebknecht qui, dans l'intervalle, s'est vainement employé à convaincre Däumig en tête à tête, insiste à nouveau pour que l'insurrection soit précédée et préparée par des manifestations de rue. Au vote, il est de nouveau battu. L'insurrection est décidée pour le lundi 11 novembre au plus tôt.
Le 7, au siège du parti social-démocrate indépendant, l'exécutif de ce parti se réunit avec les dirigeants des délégués révolutionnaires et plusieurs représentants de villes de province. Otto Brass, de Remscheid, et Dittmann, critiquent vivement les décisions prises la veille, car la situation ne leur semble pas encore mûre. Haase est plus réservé encore ; il ne croit pas à la révolution, dit que la révolte de Kiel a été une « explosion impulsive », et qu'il a promis à Noske de ne rien faire qui puisse compromettre l'« unité » entre partis social-démocrates. Liebknecht, une fois de plus, reprend ses propositions, avec, cette fois, le soutien du délégué de Düsseldorf, mais le ton a monté et il est véhément dans sa dénonciation du « mécanisme grossier des fabricants de révolution ». Une fois de plus, Däumig, Barth, Richard Müller, lui tiennent tête. La décision d'insurrection pour le 11 est maintenue. Il est décidé que l'exécutif indépendant en prendra, en tant que tel, la responsabilité dans un appel public, mais également qu'il n'y aura aucune action avant le jour J [76].
Mieux que quiconque, les social-démocrates majoritaires sentent venir la tempête. Depuis le 23 octobre, leurs ministres réclament l'abdication de Guillaume II [77]. Scheidemann et Ebert le 31 octobre, une délégation commune du parti et des syndicats, le 3 novembre [78], insistent auprès du chancelier pour obtenir le départ du Kaiser. Konrad Haenisch explique cette attitude dans une lettre privée :
« Il s'agit de la lutte contre la révolution bolchevique qui monte, toujours plus menaçante, et qui signifierait le chaos. La question impériale est étroitement liée à celle du danger bolchevique. Il faut sacrifier l'empereur pour sauver le pays. Cela n'a absolument rien à voir avec un quelconque dogmatisme républicain. » [79]
Finalement, le parti social-démocrate envoie au gouvernement un ultimatum : si l'empereur n'a pas abdiqué le 8 novembre, il ne répondra plus de rien [80].
Le 8 au matin, Otto Franke et Liebknecht font le point ensemble. Ils sont inquiets, car le temps passe. Il devient de plus en plus difficile de retenir les ouvriers qui s'impatientent et risquent de se lancer dans des actions isolées. De plus, la police serre de près les conspirateurs et conserve les moyens de décapiter le mouvement. Enfin, le parti majoritaire, qui a pris le vent, se prépare à tourner et à coiffer le soulèvement. Tout temps perdu désormais constitue un risque considérable pour les révolutionnaires. Liebknecht tente d'en convaincre Dittmann [81].
Quand les délégués se retrouvent à l'heure prévue, à leur local habituel, ils apprennent que leur spécialiste militaire, Lindner - le lieutenant Waltz - vient d'être arrêté. Ils décident alors de transférer leur séance dans les locaux du Reichstag [82]. Pendant le trajet, Däumig, qui porte dans sa serviette les plans de l'insurrection, est arrêté à son tour : Luise Zietz, qui l'accompagnait, réussit à s'esquiver et donne l'alerte. On ne peut désormais plus reculer, puisque la police a maintenant entre les mains de quoi arrêter tout le monde. Pourtant, les dirigeants indépendants, privés de Haase, qui est parti à Kiel en conciliateur, tergiversent encore. C'est Barth qui - en l'absence de Liebknecht - enlève la décision : on décide de rédiger et de diffuser un tract appelant à l'insurrection pour le renversement du régime impérial et l'établissement d'une république des conseils. Il portera dix signatures, Liebknecht et Pieck, Haase, Ledebour et Brühl, et les délégués révolutionnaires Barth, Franke, Eckert, Wegmann et Neuendorf [83].
Liebknecht n'est pas là, car il a décidé, avec ses amis spartakistes, de mettre les indépendants et les délégués devant le fait accompli et de briser avec leurs atermoiements : en compagnie d'Ernst Meyer et au nom de la Ligue Spartakus, il est en train de rédiger un autre tract - qui portera aussi sa signature appelant les ouvriers à lutter pour le pouvoir des conseils, la jonction avec le prolétariat russe dans la lutte du prolétariat pour la révolution mondiale [84]. Il ignore encore que la répression a enfin conduit ses alliés à franchir le Rubicon.
Dans la soirée, les hommes de confiance du parti social-démocrate dans les entreprises présentent leurs rapports aux responsables : ils sont unanimes à affirmer que, dans toutes les usines, les ouvriers sont prêts à passer à l'action le 9 novembre, et qu'il ne saurait être question de chercher désormais à les retenir [85]. Les appels au combat vont parvenir à des hommes décidés à se battre de toute façon.
La révolution est désormais lancée. Ceux qui la voulaient et cherchaient à la préparer, ceux qui la désiraient mais qui n'y croyaient pas et souhaitaient qu'elle soit provoquée, ceux qui ne la voulaient pas et l'avaient jusqu'au dernier moment combattue, vont, ensemble, prendre le train en marche. Les nouvelles qui parviennent de toutes les régions d'Allemagne dans la nuit du 8 au 9 le confirment : ici les marins, là les soldats, lancent des manifestations tandis que les ouvriers se mettent en grève. On désigne des conseils d'ouvriers et de soldats. Les prisons sont prises d'assaut. Le drapeau rouge, emblème de la révolution mondiale, flotte sur les édifices publics.
Berlin, 9 novembre.
Dès l'aube, les tracts appelant à l'insurrection sont distribués dans toutes les entreprises. Partout les ouvriers s'assemblent et, de tous les quartiers industriels, ils se mettent en marche vers le centre de la capitale. E. O. Volkmann écrit dans un paragraphe souvent cité :
« Le jour que Marx et son ami appelèrent de leurs vœux toute leur vie durant est enfin arrivé. Dans la capitale de l'empire la révolution est en marche. Le pas ferme, rythmé, des bataillons ouvriers fait retentir les rues : ils arrivent de Spandau, des quartiers prolétaires, du nord et de l'est, et s'avancent vers le centre, signe de la puissance impériale. Ce sont d'abord les troupes d'assaut de Barth, revolver et grenades au poing, précédées de femmes et d'enfants. Puis viennent les masses, par dizaines de mille : radicaux, indépendants, socialistes de la majorité, pêle-mêle. » [86]
L'édition matinale du Vorwärts met certes en garde contre « les actes inconsidérés » [87], mais les social-démocrates majoritaires se gardent de se mettre au travers d'un mouvement qu'ils savent irrésistible. Leurs hommes de confiance réunis encore au petit matin autour d'Ebert ont été catégoriques : les masses suivent les indépendants, échappent totalement à l'emprise majoritaire [88]. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est que la garnison résiste et qu'il y ait combat de rues ; le pire alors deviendrait possible, c'est-à-dire une révolution sanglante, et le pouvoir aux mains des extrémistes. Or, dans les casernes où les hommes ont été consignés, des incidents éclatent. Un officier du régiment des chasseurs de Naumburg se présente au Vorwärts : il dit que ses hommes sont prêts à tirer sur la foule [89]. C'est ce que les majoritaires veulent à tout prix éviter. Otto Wels se rend à la caserne Alexandre, malgré les mises en garde, harangue les hommes du toit d'une voiture et parvient à les convaincre qu'ils ne doivent pas tirer sur le peuple, mais au contraire marcher avec lui dans cette révolution pacifique [90]. Les autres régiments de la garnison suivent l'exemple des chasseurs. Un officier d'état-major, le lieutenant Colin Ross, fait savoir à Ebert que le haut-commandement a donné l'ordre de ne pas tirer [91]. Le Vorwärts tire un tract spécial : « On ne tirera pas » [92]. En fait, on ne tirera que d'une caserne ; il y aura quatre morts chez les manifestants : parmi eux, l'un des responsables spartakistes des jeunesses de Berlin, Erich Habersaath, ouvrier de chez Schwartzkopff [93]. Malgré cet épisode, tout se passe en définitive dans l'ordre, et les social-démocrates majoritaires, battus dans les usines, refont dans les casernes le terrain perdu : quand une colonne d'ouvriers que dirigent d'anciens rédacteurs du quotidien tente de s'emparer du Vorwärts - le souvenir est resté vivace de sa confiscation -, elle se heurte au barrage armé dressé par les mitrailleurs des chasseurs de Naumburg ralliés depuis deux heures à la révolution… [94]
La réunion des hommes de confiance social-démocrates a confirmé, sur proposition d'Ebert, qu'il fallait proposer aux indépendants le partage des responsabilités gouvernementales [95]. Mais Ebert, Scheidemann, Otto Braun attendent plusieurs heures une réunion de la direction indépendante, qui n'a finalement pas lieu [96]. Parmi les dirigeants indépendants présents, Dittmann est prêt à accepter la proposition majoritaire, mais Ledebour s'y oppose avec violence [97]. Il informe aussitôt le cercle des délégués révolutionnaires, qui discute cette question sans parvenir à se mettre d'accord. Un conseil de guerre improvisé autour de Barth répartit les tâches : Liebknecht se joint aux colonnes de manifestants qui marchent sur le Palais, Eichhorn se dirige vers la préfecture de police, cependant que le populaire Adolf Hoffmann gagne l'hôtel de ville à la tête des ouvriers [98].
Au Vorwärts, on constitue en toute hâte un comité d'action bientôt rebaptisé « conseil d'ouvriers et de soldats » - de douze ouvriers d'usine, tous membres du parti, auxquels on a ajouté Ebert, Otto Braun, Wels et Eugen Ernst [99]. C'est ce « conseil » qui, dans l'édition de midi du Vorwärts, lance l'appel à la grève générale et à l'insurrection pour l'établissement d'une république sociale [100]. Les social-démocrates signent leurs tracts des mots magiques : « conseil ouvrier », « conseil de soldats », « comité populaire »...
Les indépendants discutent longuement des propositions des majoritaires : ils n'ont toujours pas tranché quand, à midi, Ebert, Scheidemann, Otto Braun et le dirigeant syndical Heller sont reçus par Max de Bade, qui prend sur lui de leur annoncer l'abdication de Guillaume Il [101]. Ebert fait des réserves sur le sort futur du régime impérial, mais accepte d'assumer la charge de chancelier du Reich dans le cadre de la Constitution. Il lance immédiatement un appel au calme et à la discipline, demande que l'ordre soit maintenu [102]. A 13 heures, il informe les indépendants de la situation nouvelle, leur réitère son offre du partage des responsabilités gouvernementales. Comme Oskar Cohn lui demande s'il est prêt à accepter l'entrée de Liebknecht dans le gouvernement, il répond que son parti ne jette aucune exclusive. Les indépendants poursuivent leur débat en assurant qu'ils donneront leur réponse à 6 heures [103].
Pendant ce temps, la foule victorieuse, exaltée, roule, puissante, dans les rues de Berlin, brandit ses drapeaux, scande ses mots d'ordre, chante et se précipite à la suite des chefs qui lui proposent un objectif. Les chasseurs placés à la préfecture de police capitulent sans combat devant les hommes que dirige Eichhorn, et rendent leurs armes aux assaillants. Six cents prisonniers politiques sont libérés et Emil Eichhorn s'installe dans le bureau du préfet, dont il assume les fonctions [104]. Depuis 13 heures, sous les assauts de soldats et d'ouvriers armés, la prison de Moabit a dû ouvrir ses portes et laisser libérer de nombreux prisonniers politiques, civils ou militaires ; parmi eux, Leo Jogiches, l'organisateur de Spartakus. Quelques officiers tentent d'organiser la résistance devant l'université puis devant la bibliothèque d'État prussienne. La foule les balaie et les bâtiments du Reichstag tombent, sans coup férir [105]. Des dizaines de milliers de Berlinois sont massés devant le bâtiment : Scheidemann, du balcon, s'efforce de les inciter au calme, puis cède aux clameurs et se décide à proclamer la République - initiative quasiment révolutionnaire qu'Ebert va vivement lui reprocher [106]. Peu après, au palais impérial, Liebknecht, qui a déjà harangué la foule du toit d'une voiture, fait proclamer par acclamations la « république socialiste allemande ». Puis, monté sur le balcon de la demeure des Hohenzollern, il proclame :
« La domination du capitalisme qui a transformé l'Europe en cimetière est désormais brisée. Nous rappelons nos frères russes. Ils nous avaient dit en partant : « Si dans un mois vous n'avez pas fait comme nous, nous romprons avec vous ». Il n'a pas fallu quatre jours. Ce n'est pas parce que le passé est mort que nous devons croire que notre tâche est terminée. Il nous faut tendre toutes nos forces pour construire le gouvernement des ouvriers et des soldats et bâtir un nouvel État prolétarien, un État de paix, de joie et de liberté pour nos frères allemands et nos frères du monde entier. Nous leur tendons la main et les invitons à compléter la révolution mondiale. Que ceux de vous qui veulent voir réaliser la libre république socialiste allemande et la révolution allemande lèvent la main ! » [107]
Une forêt de bras se lèvent.
Les dirigeants révolutionnaires poursuivent toujours leurs débats. Ledebour, décidé à refuser toute forme de collaboration avec les majoritaires, semble d'abord rallier derrière lui une majorité. Mais bientôt apparaissent les premières délégations de soldats, certaines spontanées, d'autres, fort nombreuses, organisées par les majoritaires, comme celle que conduit Max Cohen-Reuss, vieux majoritaire et soldat de fraîche date. Toutes réclament instamment l'unité des socialistes, leur alliance au gouvernement pour défendre la révolution, la paix, la fraternité. D'autres délégations, notamment d'ouvriers, réclament, quant à elles, l'entrée de Liebknecht dans le gouvernement comme caution de la volonté de paix de la révolution allemande. Lorsque Liebknecht arrive, en fin d'après-midi, il estime qu'il est impossible aux indépendants de refuser catégoriquement toute collaboration avec les majoritaires, comme le propose Ledebour, sans courir le risque de n'être pas compris et d'apparaître aux masses comme ennemi de l'unité à laquelle elles aspirent [108]. Soutenu par Richard Müller et Däumig, il obtient que soient posées six conditions : proclamation de la république socialiste allemande, remise du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire aux représentants élus des ouvriers et des soldats, pas de ministres bourgeois, participation des indépendants limitée au temps nécessaire à la conclusion de l'armistice, ministères techniques soumis à un cabinet purement politique, parité de la représentation des partis socialistes au sein du cabinet [109]. Seul Ledebour se déclare opposé à la participation, même à ces conditions [110].
A 20 heures, la réponse des dirigeants indépendants est enfin communiquée aux majoritaires : ceux-ci, dans l'intervalle, avaient tenté une nouvelle démarche, affirmant que la délégation chargée de signer l'armistice ne partirait qu'après la formation du gouvernement. A 21 heures, la réponse des majoritaires parvient aux indépendants. Les dirigeants du parti d'Ebert ne souscrivent qu'aux deux dernières conditions et rejettent les quatre premières. Pour eux, seule une assemblée constituante élue au suffrage universel peut décider de la nature du régime allemand, et le gouvernement provisoire doit rester en place jusqu'à sa convocation et son élection. Ils affirment surtout leur hostilité à toute « dictature de classe », et souhaitent la participation de partis bourgeois au gouvernement [111]. Profondément divisés, les dirigeants indépendants, toujours privés de Haase, remettent leur décision définitive au lendemain [112]. Dans la soirée paraissent à Berlin les deux journaux quotidiens d'extrême-gauche imprimés dans les locaux de grands quotidiens occupés dans la journée : Die Internationale, organe indépendant et Die Rote Fahne organe spartakiste [113].
A 22 heures, les délégués révolutionnaires, auxquels se sont joints plusieurs centaines de représentants des ouvriers insurgés, se réunissent sous la présidence de Barth dans la grande salle des séances du Reichstag [114]. L'assemblée, qui se considère provisoirement comme le conseil des ouvriers et des soldats de la capitale, décide d'appeler à des réunions dans les usines et les casernes le lendemain 10 novembre à 10 heures ; on élira les délégués un pour 1000 ouvriers et un par bataillon - à l'assemblée générale prévue à 17 heures au cirque Busch, afin de désigner le nouveau gouvernement révolutionnaire [115]. Les social-démocrates majoritaires, dont cette décision risque de menacer les positions conquises dans la journée, n'émettent sur l'instant aucune protestation ; mais ils vont consacrer la nuit à préparer cette bataille décisive.
L'installation du gouvernement Ebert.
Le rôle de Wels avait été capital dans la journée du 9 ; son action, largement improvisée, avait en effet permis aux social-démocrates majoritaires de trouver les appuis nécessaires dans la garnison de Berlin. C'est ainsi que, dans la soirée, un groupe d'officiers, parmi lesquels figure le lieutenant Colin Ross, signe un appel aux officiers pour qu'ils collaborent au maintien de l'ordre et appuient le nouveau gouvernement [116]. Il s'agit maintenant pour les majoritaires d'organiser systématiquement cet appui et de l'utiliser pour l'assemblée générale du cirque Busch.
Dans la nuit du 9 au 10, Wels rédige et fait imprimer à 40 000 exemplaires un tract qu'il adresse « aux hommes de troupes qui soutiennent la politique du Vorwärts » [117]. Il est nommé par Ebert commandant militaire de la capitale [118], et le colonel Reinhard donne à tous les commandants d'unités des ordres pour que les hommes accrédités par lui aient libre accès aux casernes [119]. Le thème de l'action des hommes de Wels est donné par le gros titre du Vorwärts : « Pas de lutte fratricide » [120].
Haase est arrivé pendant la nuit. D'abord enclin au refus de la participation, il a changé d'avis quand l'exécutif se réunit, à 10 heures, et insiste pour que le parti indépendant ne fasse pas obstacle à l'entente de tous les socialistes en maintenant intégralement ses conditions de la veille. Ni Liebknecht, ni les dirigeants des délégués révolutionnaires, pris par la préparation et les réunions ou assemblées d'usines, ne sont présents, mais Liebknecht, qui a été tenu au courant, fait savoir qu'il ne participera pas au gouvernement si le parti indépendant renonce à ses conditions [121]. Les pourparlers se poursuivent néanmoins sans lui, et finalement, à 13 heures 30, les représentants des deux partis social-démocrates se mettent d'accord sur un texte :
« Le cabinet est formé exclusivement de social-démocrates, qui sont commissaires du peuple avec des droits égaux. Cela ne s'applique pas aux portefeuilles ministériels, assistants techniques du cabinet qui est seul à déterminer la politique. Chaque ministère est contrôlé par deux membres des partis social-démocrates. Ces contrôleurs ont des pouvoirs égaux. Le pouvoir politique est entre les mains des conseils d'ouvriers et de soldats, qui seront très bientôt convoqués à une réunion représentant l'ensemble du Reich. La question de l'Assemblée constituante ne sera pas posée avant la consolidation de l'ordre actuellement établi par la révolution, et elle fera l'objet de discussions ultérieures. » [122]
Les dirigeants des deux partis se sont aussi mis d'accord sur des noms : à Ebert, Scheidemann et Landsberg, désignés la veille par les majoritaires, se joindront Dittmann, Haase et Barth, pour les indépendants [123].
A 14 heures, dans les locaux du Vorwärts, Wels réunit les hommes de confiance de son parti dans les entreprises et les délégués des soldats afin de préparer la réunion du cirque Busch, dont il est essentiel qu'elle entérine l'accord conclu au sommet. Il explique aux soldats que, contre les partisans du pouvoir des seuls ouvriers, il faut défendre les droits du « peuple entier » et réclamer l'élection d'une assemblée nationale [124]. L'un des responsables présents à ses côtés, Richard Fischer, reconnaît dans la foule des soldats le fils d'un des vétérans du parti : c'est ainsi que le soldat Brutus Molkenbuhr va devenir le chef de file des soldats majoritaires [125].
L'assemblée commence avec un important retard. Plus de 1500 délégués occupent la salle, les ouvriers dans le haut, les soldats en bas, encadrant la tribune [126]. L'atmosphère est houleuse, on interrompt fréquemment l'orateur, on brandit des armes, on s'empoigne. Le service d'ordre, presque inexistant, a laissé entrer nombre de personnes sans mandat : à plusieurs reprises des rixes éclatent et l'on craint des échanges de coups de feu. C'est Barth qui préside en tant que représentant du « conseil ouvrier » : il fait sans difficulté ratifier la composition d'un bureau qui a peut-être fait l'objet d'une négociation antérieure : le lieutenant Waltz est vice-président, Brutus Molkenbuhr secrétaire. Puis il donne la parole à Ebert pour exposer la situation :
« Les conditions d'armistice imposées par les capitalistes et les impérialistes de l'Entente sont très dures, mais il faut les accepter pour mettre fin au massacre. » [127]
Il annonce aux délégués que les deux partis social-démocrates se sont mis d'accord pour constituer ensemble un gouvernement paritaire sans aucun ministre bourgeois. Haase lui succède, qui parle dans le même sens et confirme l'accord.
Liebknecht, très calme, mais incisif, n'a pas la partie facile : l'écrasante majorité des soldats est contre lui, hachant son discours d'interruptions, d'injures, le menaçant même de leurs armes, scandant : « Unité ! Unité ! » à chacune de ses attaques contre les majoritaires. Il met en garde les délégués contre les illusions de l'unité, rappelle la collaboration des majoritaires, « ces gens qui vont aujourd'hui avec la révolution et qui avant-hier encore étaient ses ennemis », avec l'état-major, dénonce les manœuvres qui visent à utiliser les soldats contre les ouvriers, répète : « La contre-révolution est déjà en marche, elle est déjà en action, elle est au milieu de nous ! » [128]
L'élection du comité exécutif des conseils de Berlin donne lieu à une bataille confuse. Barth propose d'abord d'élire le bureau de l'assemblée, soit dix-huit membres, neuf soldats et neuf ouvriers. Richard Müller présente une liste préparée par les délégués révolutionnaires, qui comprend les membres du noyau qui a préparé l'insurrection et, aux côtés des principaux délégués, Barth, Ledebour Liebknecht et Rosa Luxemburg. Mais les soldats vocifèrent de plus belle. Le délégué social-démocrate Büchel réclame alors la représentation paritaire des deux partis ouvriers. Ebert le soutient ; Barth et Richard Müller combattent sa proposition. Les soldats agitent leurs armes, scandent « Parité ! » Ebert fait mine de retirer la proposition de Büchel. Mais un ouvrier de l'imprimerie affirme qu'aucun journal ne paraîtra tant que ne sera pas établi un gouvernement paritaire. Un délégué des soldats dit que ces derniers formeront leur propre exécutif si la parité ne fait pas l'objet d'un accord. La revendication de la parité pour la représentation ouvrière est en réalité exorbitante, car les social-démocrates sont loin d'avoir dans les usines une représentation comparable à celle des indépendants. Aussi le bureau unanime, social-démocrates compris, formule-t-il une proposition de compromis : neuf indépendants et trois majoritaires pour représenter les ouvriers. Mais les soldats, encadrés par les hommes de Wels, continuent leur obstruction. Barth finit par céder et émet une proposition conforme à leurs exigences : un exécutif formé de douze délégués des soldats, social-démocrates majoritaires ou influencés par eux, et de douze délégués des ouvriers, dont six « majoritaires » et six indépendants. Liebknecht, dont le nom est mis en avant ainsi que ceux de Pieck et de Rosa Luxemburg, pour figurer dans la liste des six délégués indépendants, refuse avec indignation, proteste contre ce viol grossier de la démocratie la plus élémentaire où une minorité bruyante interdit en définitive à la majorité de se prononcer par un vote. Finalement, six membres du noyau des délégués révolutionnaires acceptent de se porter candidats comme représentants de la fraction « indépendants » des délégués ouvriers : ce sont Barth, Richard Müller, Ledebour, Eckert, Wegmann et Neuendorf. Après une brève suspension de séance, Richard Müller, au nom des élus, vient proposer à l'assemblée la ratification de la liste des six commissaires du peuple déjà désignés par leurs partis respectifs et la séance est levée [129].
La deuxième journée de la révolution allemande a donc vu les social-démocrates, qui avaient tout fait pour l'empêcher, remporter une victoire incontestable : leur chef, Ebert, chancelier du Reich par la grâce de Max de Bade, commissaire du peuple par celle des états-majors des deux partis social-démocrates, voit sa position ratifiée par la première assemblée des conseils de la capitale, et devient simultanément chef du gouvernement légal et du gouvernement révolutionnaire.
Il ne faut pourtant pas exagérer l'importance de la défaite des révolutionnaires au deuxième jour de la révolution : celle-ci ne fait que commencer. C'est du moins ce que l'on pense à Moscou, où se déroulent des manifestations de joie spontanées. Radek écrira plus tard :
« Des dizaines de milliers d'ouvriers éclatèrent en vivats sauvages. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Tard dans la soirée, ouvriers et soldats rouges défilaient encore. La révolution mondiale était arrivée. Notre isolement était terminé. » [130][source : marxists.org]
Notes
[1] Badia, op. cit., t. I, p. 93.
[2] Ibidem, p. 94.
[3] Ibidem, pp. 94-95.
[4] Cité par F. Payer, Von Bethmann-Hollweg bis Ebert. Erinnerungen und Bilder, p. 82.
[5] Voir les discussions au sein de la direction social-démocrate dans Hermann Müller, Die Novemberrevolution, pp. 10-11.
[6] Vorwärts 21 octobre 1918 : «Dictature ou démocratie. »
[7] Max von Baden, Erinnerungen und Dokumente, p. 571.
[8] Tormin, Zwischen Räte diktatur und sozialer Demokratie, p. 32.
[9] Dans la brochure Die Diktatur des Proletariats.
[10] E. Barth, Aus der Werkstatt der deutschen Revolution, p. 35.
[11] Lettre du 18 octobre 1918, Dok. u. Mat., Il/2, p. 255.
[12] Dok. u. Mat., II/2, pp. 228-243.
[13] Voir les délibérations dans Die Regierung des Prinzen Max von Baden, passim.
[14] Ibidem, séances du 6 octobre, p. 88, du 10, p. 129, du 12, pp. 129, 167.
[15] Ibidem, p. 305 et Max von Baden, op. cit., p. 476.
[16] Selon Otto Franke, Vorwärts und..., pp. 273-274.
[17] Ibidem.
[18] Unter der roten Fahne, p. 108.
[19] Ibidem, p. 110.
[20] Vorwärts und ..., pp. 270-273.
[21] Ch. Beradt, Paul Levi, p. 18.
[22] Vorwärts und..., p. 30, où il précise être revenu le 26 octobre.
[23] Radek, November..., p. 132.
[24] Carnet de Liebknecht : extraits dans Ill. Gesch., p. 203 et Pieck, Corr. Int., n° 136, 14 novembre 1928, p. 1507. Selon J. S. Drabkin, op. cit., pp. 102-103, le Fonds Karl Liebknecht àl'I.M.L. de Moscou, contient une copie dactylographiée portant à la fin la mention manuscrite «Tagebuch von K. Liebknecht ? » (Fonds 210, liste 1, Akte n'°1397, f. 1). Il précise que ce sont des extraits de ce texte qui ont paru dans Illustrierte Geschichte.
[25] Ill. Gesch., p. 203. Le Vorwärts du 29 novembre consacre un article aux rapports entre Liebknecht et les indépendants qui ne peuvent, selon lui, s'établir que dans la confusion.
[26] Ibidem et Pieck, op. cit., p. 1507.
[27] Ibidem.
[28] Ill. Gesch, II, p. 87.
[29] Ill. Gesch., p. 203.
[30] Ibidem.
[31] Ibidem. Drabkin, op. cit., p. 104, qui suit l'original du carnet de Liebknecht mentionné à la note 24, précise qu'il s'agit de Barth.
[32] Ill. Gesch., p. 203.
[33] Ibidem.
[34] Hermann Müller, op. cit., p. 94.35.
[35] Pieck, op. cit., p. 1507.
[36] Ibidem et Ill. Gesch., p. 203.
[37] Ibidem.
[38] Kolb, Arbeiterräte in den deutschen Innenpolitik, p. 63.
[39] « Journal d'un spartakiste », Ill. Gesch., p. 182.
[40] Ill. Gesch. II, p. 82.
[41] Kolb, op. cit., p. 63, Ill. Gesch., p. 182, etc.
[42] Kolb, op. cit., p. 64. Le compte rendu des décisions du conseil ouvrier de Stuttgart du 4 novembre, dans Die Rote Fahne du 5 novembre 1918, Dok. u. Mat., II/2, pp. 285-286.
[43] Kolb, op. cit., p. 65.
[44] Die Regierung des Prinzen Max von Baden, pp. 541-545. Selon le Berliner Tageblatt du 7 novembre, figuraient dans le matériel de propagande saisi une brochure de Radek intitulée Der Zusammenbruch des Imperialismus und die Aufgabe der internationalen Arbeiterklasse, texte d'un discours prononcé à Moscou le 7 octobre, ainsi que le texte d'un tract distribué dans l'usine Daimler de Stuttgart dans les jours précédents.
[45] Kolb, op. cit., p. 71.
[46] Vorwärts und..., p. 91.
[47] Ibidem, p. 92.
[48] Ibidem, pp. 72-73.
[49] H. Müller, op. cit., p. 26 ; Noske, Von Kiel bis Kapp, pp. 8-24.
[50] Vorwärts und..., pp. 108-122.
[51] Kolb, op. cit., p. 78.
[52] Ill. Gesch., II, p. 116.
[53] Ibidem, pp. 116-117.
[54] Kolb, op. cit., p. 79.
[55] Ill. Gesch., II, p. 117.
[56] Kolb, op. cit., p. 77.
[57] Ibidem.
[58] Ill. Gesch., II, p. 113.
[59] Ibidem, p. 191.
[60] Ibidem, p. 193.
[61] Kolb, op. cit., p. 77.
[62] Vorwärts und..., p. 251.
[63] Ill. Gesch., p. 192.
[64] Vorwärts und..., pp. 472-477.
[65] Kolb, op. cit., p. 67.
[66] Ibidem, p. 68.
[67] Ibidem, pp. 69-70.
[68] Vorwärts und..., p. 367.
[69] Ill. Gesch. II, p. 135.
[70] Vorwärts und..., pp. 426-427.
[71] F. Schnellbacher, Hanau in der Revolution, p. 13, cité par Ill. Gesch., II, pp. 128-129.
[72] Ill. Gesch. II, p. 130.
[73] Vorwärts und..., p. 406.
[74] Ibidem, pp. 407-408.
[75] Ibidem, pp. 469-470.
[76] Pieck, op. cit., p. 1507.
[77] Scheidemann, Memoiren, II, p. 262.
[78] Max von Baden, Erinnerungen und Dokumente, pp. 539 et 591.
[79] Cité par Kolb, op. cit., p. 32.
[80] Hermann Müller, op. cit., p. 45.
[81] Ill. Gesch., p. 204.
[82] Pieck, op. cit., p. 1507.
[83] Ibidem, p. 1508. Texte dans Emil Barth, Aus der Werkstatt der deutschen Revolution, p. 53.
[84] Pieck, op. cit., p. 1508. Texte dans Dok. u. Mat., II/2, pp, 324-325.
[85] Hermann Müller, op. cit., p. 45.
[86] E. O. Volkmann, La Révolution allemande, pp. 35-36. Cläre Derfert-Casper, dans ses souvenirs, mentionne un autre ordre, plus vraisemblable : « Devant, les hommes armés, puis les hommes sans armes, et enfin les femmes », Ill. Gesch., II, p. 149.
[87] Vorwärts, 9 novembre. Un supplément appellera quelques heures plus tard à la grève générale.
[88] Hermann Müller, op. cit., p. 46.
[89] Ibidem, pp. 47-48.
[90] Ibidem, p. 48.
[91] Ibidem, p. 49.
[92] Ibidem, p. 48.
[93] Ill. Gesch., p. 206.
[94] Hermann Müller, op. cit., p. 49.
[95] Ibidem, p. 50.
[96] Ill. Gesch., p. 208.
[97] H. Müller, p. 50 et Pieck, op. cit., p. 1058.
[98] Ibidem, p. 1058.
[99] Ibidem, p. 49.
[100] Dok. u. Mat., II/2, p. 330.
[101] H. Müller, op. cit., p. 51.
[102] Dok. u. Mat., II/2, p. 333.
[103] H. Müller, op. cit., p. 52.
[104] E. Eichhorn, Meine Tätigkeit im Berliner Polizeipräsidium und mein Anteil an den Januar-Ereignissen, p. 8.
[105] Ill. Gesch., II, p. 152.
[106] H. Müller, op. cit., p. 53. Scheidemann, Memoiren, II, p. 313.
[107] Vossische Zeitung, 10 novembre 1918; Ill. Gesch., pp. 209-210.
[108] Pieck, op. cit., p. 1058.
[109] Ill. Gesch., p. 210 - Vörwarts, 10 novembre 1918.
[110] Pieck, op. cit., p. 1058.
[111] Ibidem, p. 58.
[112] Ibidem, p. 58.
[113] Pieck, op. cit., p. 1058.
[114] Ibidem et H. Müller, op. cit., p. 58.
[115] H. Müller, op. cit., p. 58.
[116] Texte dans Hermann Müller, p. 61.
[117] Ibidem, p. 62.
[118] Ibidem, p. 82.
[119] Kolb, op. cit., p. 117, n° 6.
[120] Vorwärts, 10 novembre 1918.
[121] Ill. Gesch., p. 211.
[122] Ibidem, pp. 210-211.
[123] H. Müller, op. cit., p. 65.
[124] Ibidem, p. 69.
[125] Ibidem, p. 70.
[126] Nous avons suivi ici le récit donné dans Vossische Zeitung, 11 novembre 1918, que nous avons confronté avec ceux donnés par H. Müller (op. cit., pp. 70-72, et R. Müller, pp. 3637). Il existe àl'I.M.L. de Berlin un compte rendu sténographique de cette assemblée (« LM.L.Z.P.A., n° 11/18. Informationsstelle der Reichsregierung. 45 f »). Des extraits de ce mouvement sont cités par J. S. Drabkin, op. cit., pp. 165-167.
[127] Vossische Zeitung, 11 novembre 1918.
[128] Cité par Drabkin, op. cit., p. 166.
[129] Ibidem et Drabkin, op. cit., pp. 165-167.
[130] Krasnaja Nov, n° 10, 1926, p. 140. Trad. all., « November. Eine kleine Seite aus meinen Erinnerungen », Archiv für Sozialgeschichte, Il, 1962, p. 121. (Références ultérieures : Radek, November...)